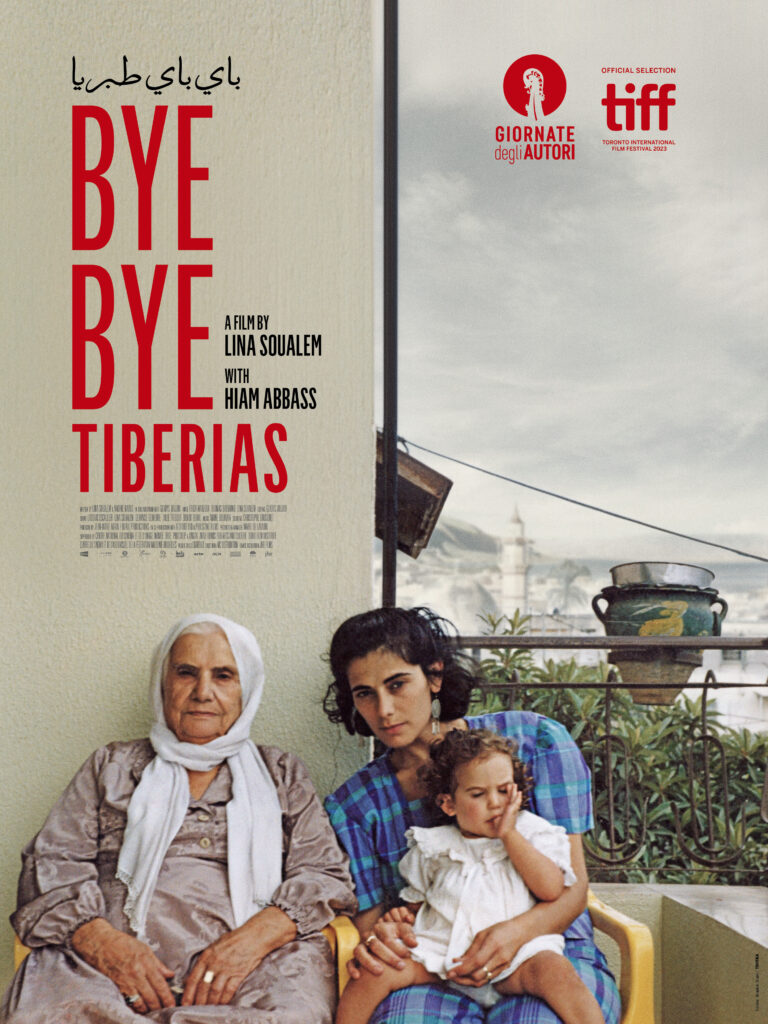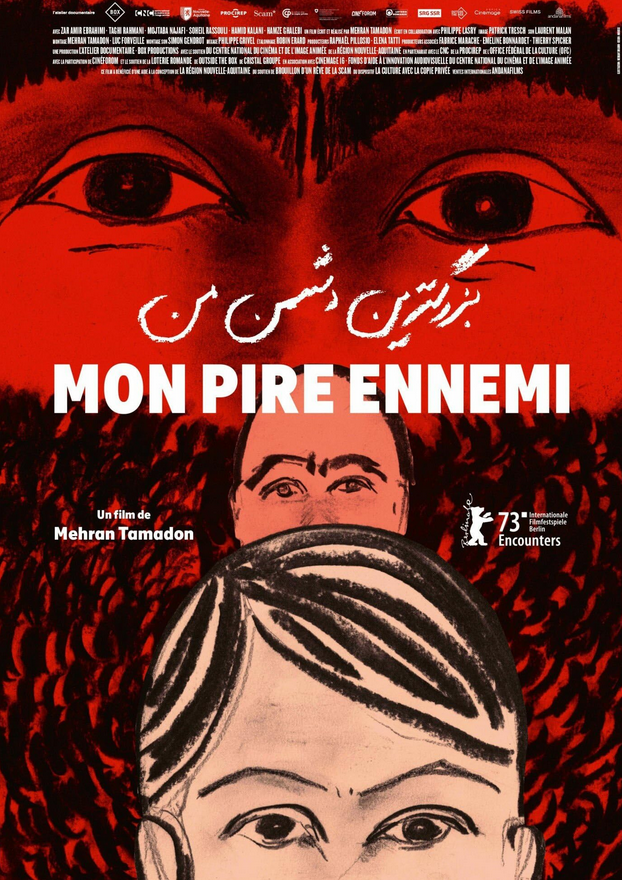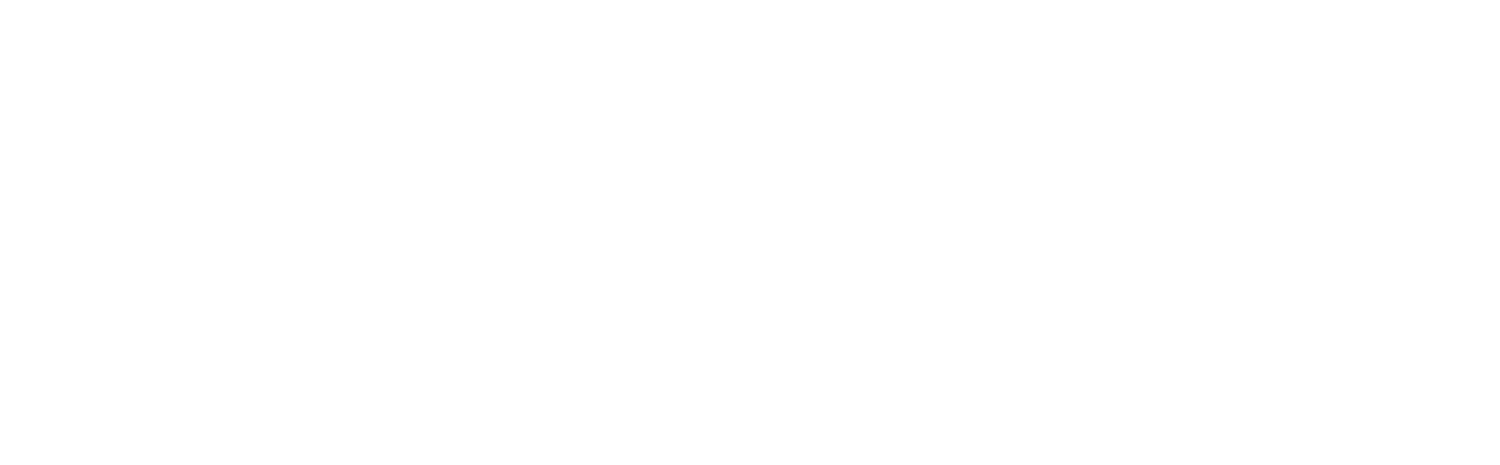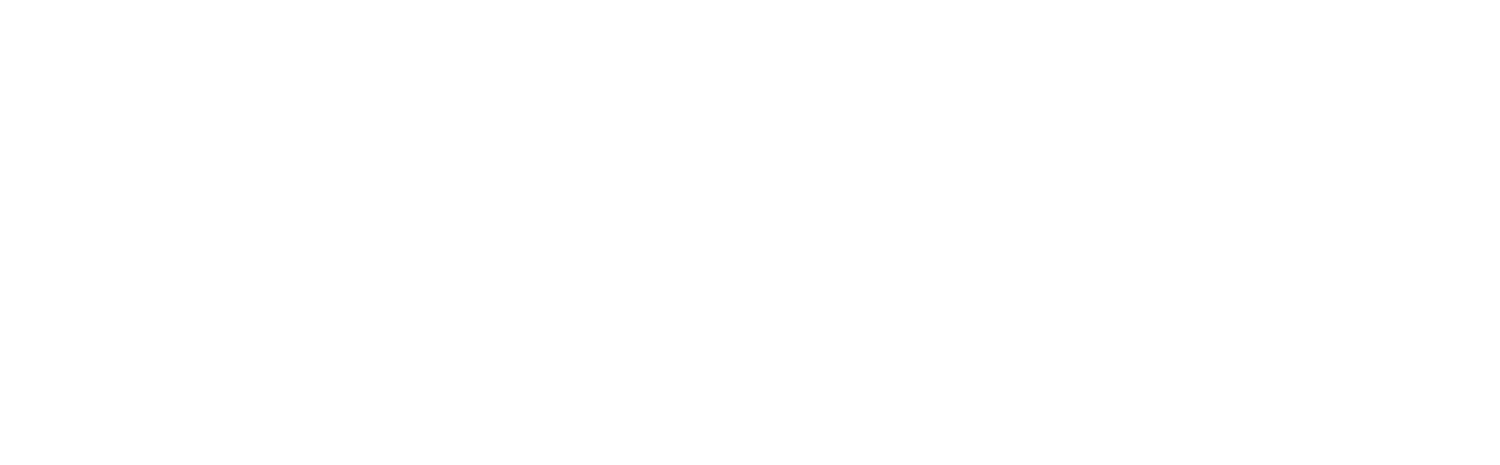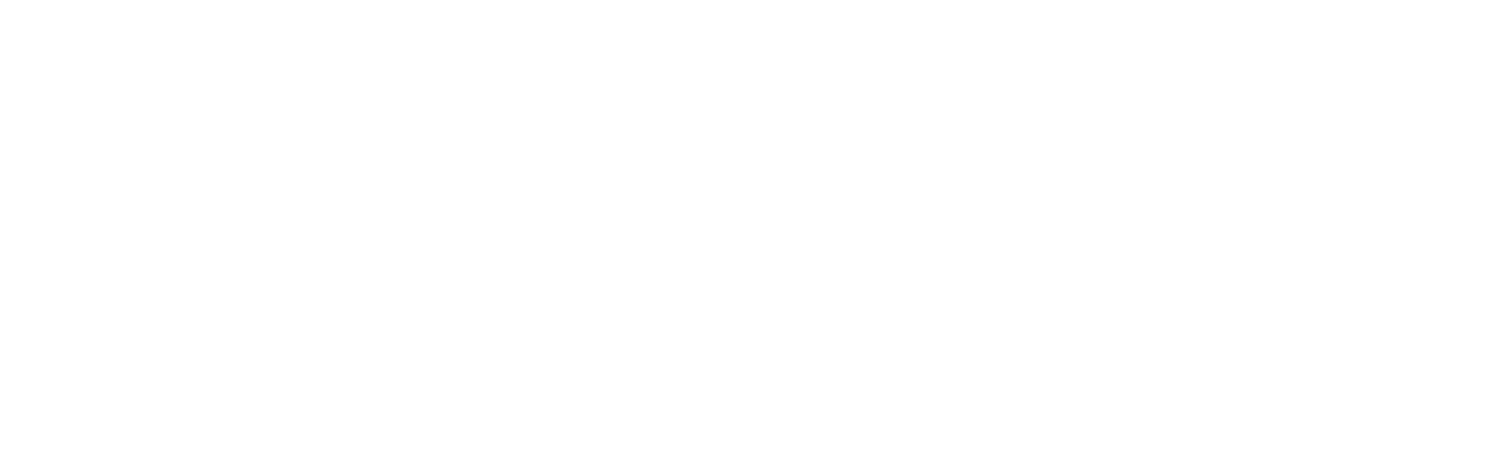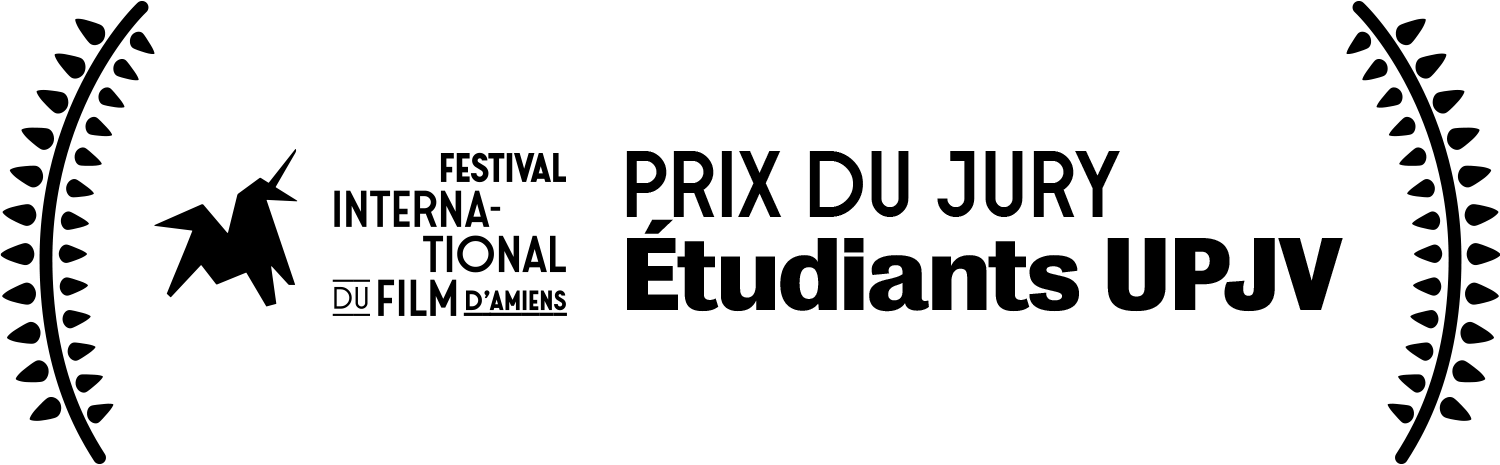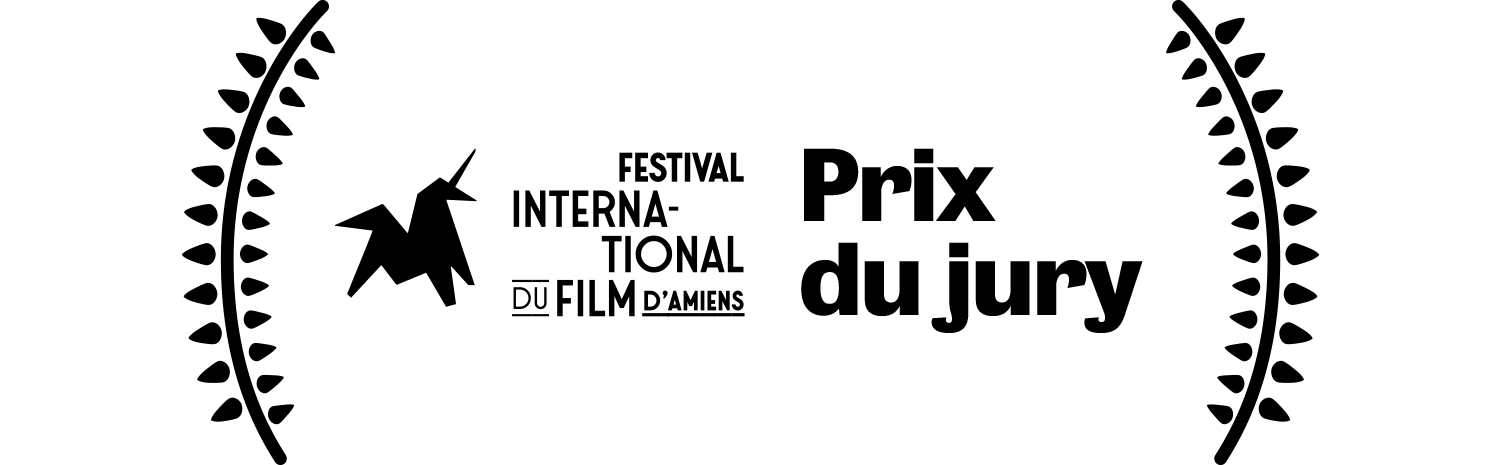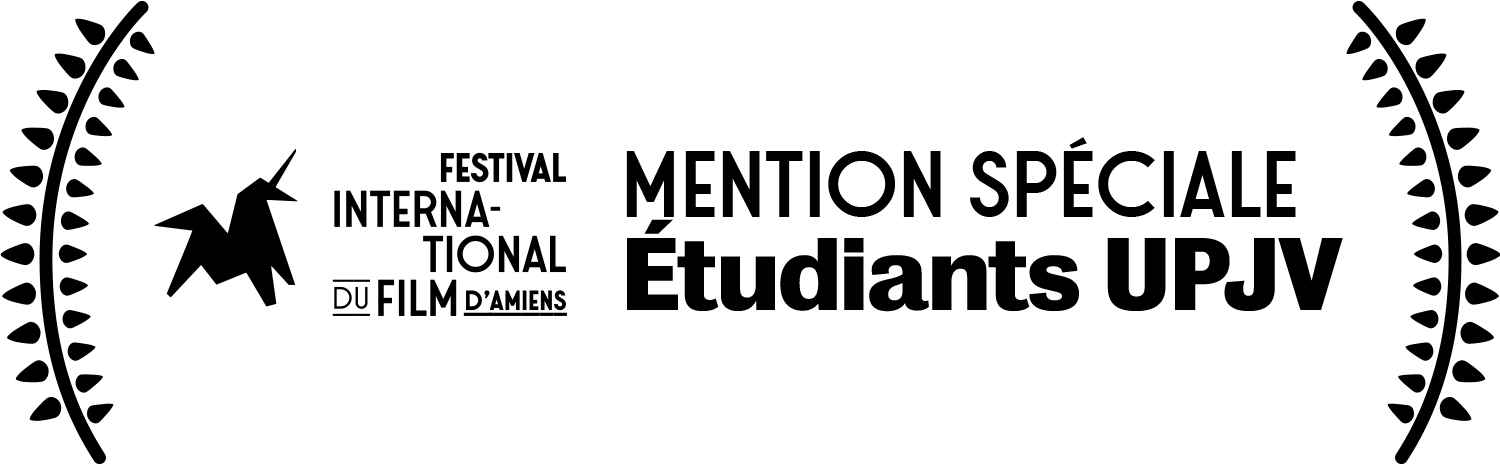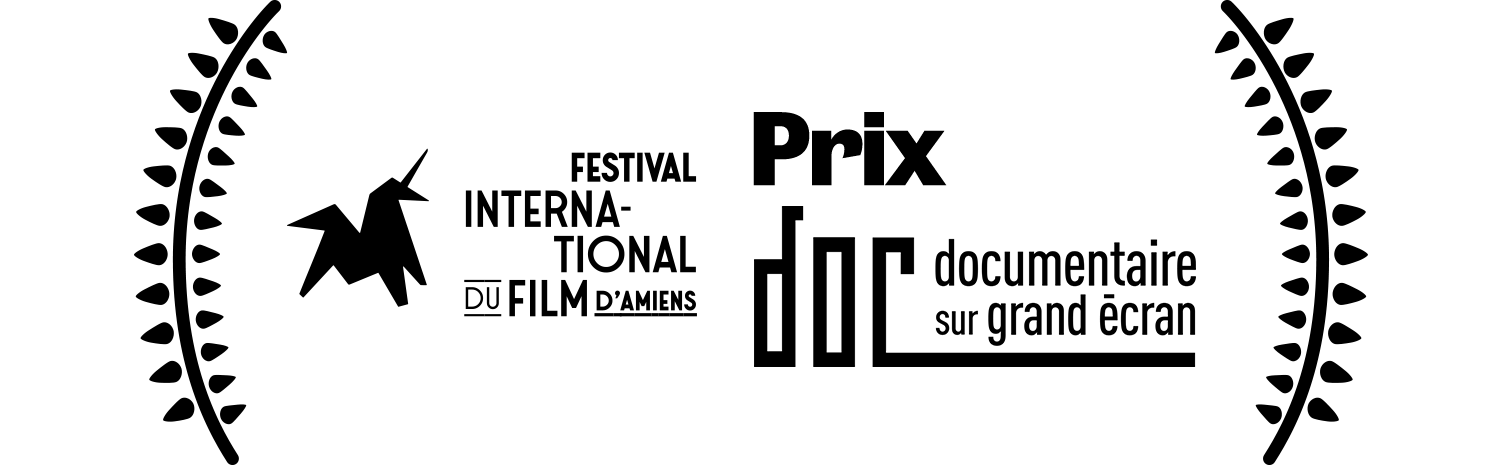Sections
2023
Les sections de l’édition 43 du Festival Internationnal du Film d’Amiens

Ouverture et Clôture

Compétition

Vache-caméra

Les disparu.e.s d’Amérique latine : traces et persistances

Davy Chou, Anti-Archive

Coups de coeur

Jeune Public

Gay Rom Com

Tournés dans les Hauts-de-France

Partenariat avec la Fémis
Awards
2023
Le palmarès de l’édition 43 du Festival Internationnal du Film d’Amiens
Master awards
Awards
Dress code : Fleurs ! 🌼
Marguerite, Camomille.. les vaches portent souvent des noms de fleurs !
Rendons leur hommage avec vos plus belles tenues ou accessoires fleuris.
Cérémonie d’ouverture ![]()
![]()

Vendredi 10 novembre · 20h · Maison de la Culture
Cérémonie d’ouverture, suivie de la projection de Mars Attacks! et d’un DJ set.
Samedi 11 novembre · 21h · Ciné St-Leu
Orlando, ma biographie politique de Paul B. Preciado, en avant-première et en présence de Naelle Dariya et Tal Madesta, en partenariat avec Divergenre, association amiénoise transgenre et non-binaire.
Dimanche 12 novembre · 16h30 · Pathé
Madame de Sévigné d’Isabelle Brocard, en avant-première
et en présence de la réalisatrice.
Lundi 13 novembre · 20h · Pathé
Le Bonheur est pour demain de Brigitte Sy, en avant- première et en présence de la réalisatrice et de Damien Bonnard.
Jeudi 16 novembre · 21h · Ciné St-Leu
Conann de Bertrand Mandico, en avant-première et en présence de l’actrice Naelle Dariya et l’auteur, journaliste Tal Madesta et les actrices Sandra Parfait et Nathalie Richard.
Vendredi 17 novembre · 20h · Maison de la Culture
Cérémonie de clôture et remise des prix, suivie d’une projection surprise au cinéma Orson Welles
et d’une fête à La Lune des Pirates en partenariat avec Les Morues Électriques.
Focus sur Davy Chou : Anti-Archive

Le cinéaste producteur sera présent du mardi 14 novembre au vendredi 17 novembre pour vous rencontrer.
Les temps forts :
Mardi 14 nov. · 20h30 · Retour à Séoul de Davy Chou · Séance suivie d’un débat
Mercredi 15 nov. · 18h30 · New Land Broken Road de Kavich Neang · Cambodge · 2018 + White Building de Kavich Neang · Séance suivie d’un débat avec Davy chou
Jeudi 16 nov. · 13h30 · Le Goût du secret de Guillaume Suon · Séance suivie d’un débat avec Guillaume Suon et Davy chou
Rencontre avec Rosine Mbakam

Les temps forts :
Mardi 14 novembre · 18h30 · Ciné St-Leu : AVP Mambar Pierrette, 2023
Mercredi 15 novembre · 10h30 · Cinéma Orson Welles : table-ronde
Mercredi 15 novembre · 14h · Cinéma Orson Welles : Chez Jolie coiffure, 2018
43
10 18
Nov.2023
Edito « Adieu Marguerite, ma vieille copine, cela me fait de la peine mais je n’aurais pas pu te garder de toute manière, j’habite au 4ème étage sans ascenseur. » Ainsi Fernandel dit ses adieux à sa compagne dans La Vache et le Prisonnier. S’il est impossible d’avoir une vache dans son salon, que nous vivions à la ville comme à la campagne, nous portons tous.tes une vache en nous.
Venant de l’enfance, captée un instant au fil d’un voyage en train, admirée dans un tableau paisible ou côtoyée au quotidien dans le travail, elle nous habite, sans nous en rendre compte souvent, discrète. Et elle habite tout autant le cinéma, traversant une multitude de plans, se déployant sur les écrans au gré des époques, surgissant dans des films de tout genre et de tout coin du monde. Animal souvent moqué, jugé parfois trivial, les vaches sont pourtant aimées et estimées en secret par beaucoup d’entre nous. Il est temps de célébrer leur noblesse et nous rassembler autour de ce qu’elles évoquent d’intime en chacun de nous. Plongeons nous dans le travail de cinéastes pour qui elles sont une source d’inspiration, laissons nous porter par tous les fantasmes et fantasmagories que l’humain projette sur elles, tous les mythes et toutes les folies qu’elles charrient. Mais allons aussi au-devant de leur silence pour tenter d’identifier ce qui s’y dit comme l’écrit le philosophe animaliste Jean-Christophe Bailly, plongeons nous dans leur regard comme nous plongeons dans le regard caméra de la superbe affiche des sœurs Decormeille, affiche douce et forte à la fois, drue et poétique – telle une vache.
Le cinéma est une affaire de cadre. Décentrer l’humain pour faire des vaches les héroïnes est un geste poétique et éthique. La programmation de cette année sera traversée par cette question, mettre au centre les excentré.e.s, les marginalisé.e.s, mettre la lumière sur les invisibles, accorder et rendre un regard aux invisibilisé.e.s par la pensée et la matière filmique. Ainsi, la section « Disparu.e.s d’Amérique latine : traces et persistances » témoigne du pouvoir du cinéma de recueillir et exhumer les traces des disparu.e.s, victimes des dictatures qui ont marqué l’Amérique latine au XXe siècle, tué.e.s, effacé.e.s par le pouvoir. Il met au jour ces violences tues, qui s’inscrivent dans la lignée des violences de la colonisation, dont l’empreinte est encore vive dans les sociétés d’aujourd’hui. Mais le cinéma permet aussi de donner corps à la lutte de ces victimes, à leurs résistances, dans un défi à la mort, à l’oubli.
Le cinéma lui-même peut être invisible. Le genre de la comédie romantique est souvent mal-aimé, malmené, dévalorisé alors que nous pouvons tous.tes avouer sans exception comme il est délicieux de sortir les mouchoirs. Mais ce genre est encore plus injustement méconnu et déconsidéré lorsqu’il s’agit de comédies romantiques mettant en scène des personnages gay. La section « Gay Rom Com » tente de réparer cela avec quatre films rares. Jouant avec les codes, abordant des questions politiques profondes (le sida, le coming out, le racisme…), ils feront frémir votre coeur et apporteront des papillons au festival. Celui qui joue aussi avec les codes, c’est bien Davy Chou, notre invité phare de cette année. Cinéaste, il s’est aussi emparé du métier de producteur en créant au Cambodge une société de production, Anti-Archive, qui nourrit collectivement l’élan d’un nouveau cinéma cambodgien.
Le festival sera lui aussi sous le signe du collectif, fabriqué en équipe, fruit de nos réflexions et notre travail, de nos discussions passionnées. Nous espérons que l’effervescence et l’enthousiasme du bureau se déverseront joyeusement dans les couloirs et dans les salles et qu’elles permettront les rencontres entre les spectateur.ice.s, les équipes, les bénévoles, les juré.e.s et surtout avec la ribambelle d’invité.e.s. Réalisatrices (Rosine Mbakam, Euzhan Palcy, Brigitte Sy, Maud Alpi pour n’en citer que quelques unes), acteur.ice.s (Damien Bonnard, Naelle Dariya, Sandra Parfait, Nathalie Richard..) et un grand nombre de métiers divers du cinéma seront présent.e.s, notamment grâce aux journées professionnelles qui se déploieront sous la claire verrière de la Maison de l’Architecture. À l’image des partenariats riches et stimulants où le cinéma côtoie les autres arts, écrivain.e.s, (Tal Madesta…), musicien.ne.s (Jî Drû…) et d’autres artistes viendront ouvrir encore notre regard et créer des croisements entre les disciplines, construisant ainsi une belle voûte sous laquelle se réunir et échanger. Lorsque les portes seront closes, que les micros seront coupés, nous prendrons rendez-vous chaque soir avec vous dans les bars chaleureux d’Amiens, pour que les rencontres se poursuivent, pour que la joie perdure.
M’appelant un instant Marguerite ou Camomille, empruntant un prénom de vache, je signe cet édito avec une fleur. Celle de votre choix, votre préférée, celle que j’espère je verrai à votre boutonnière, dans vos cheveux ou épanouie sur les robes et les chemises pour qu’un air printanier souffle sur cette édition et vienne réchauffer nos cœurs.
Marie-France Aubert
Directrice Artistique